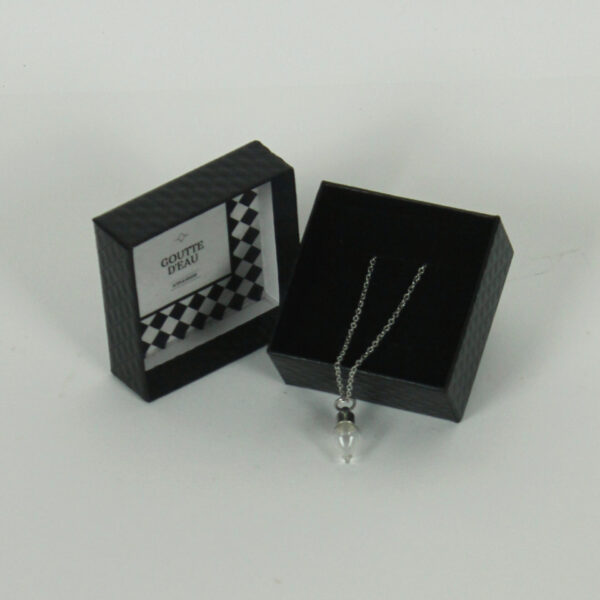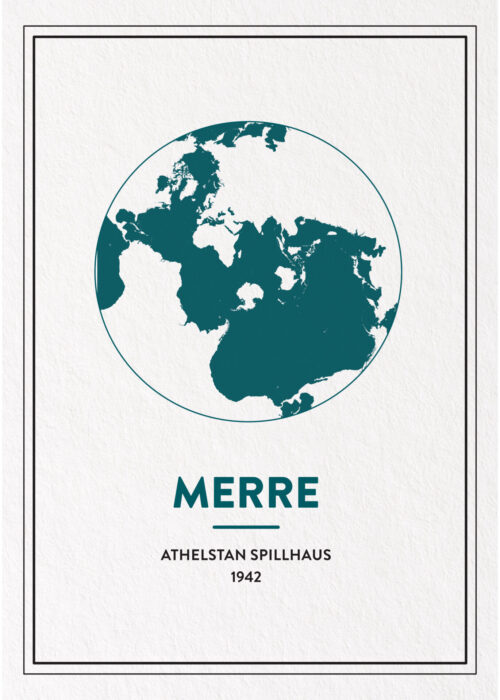À propos
Fondé à l’intersection de l’art, du design et de la prospective, le Musée d’Archéologie des Futurs (MAF) est une institution pionnière dédiée à l’exploration des futurs possibles. Le MAF connecte des personnes de tous âges et origines aux cultures et sociétés du futur. Nous aspirons à être un catalyseur d’imagination collective, d’expérimentation, d’apprentissages et de créativité, un lieu de rencontre et de débat pour toustes et une fenêtre sur les futurs possibles dans toute leur diversité.
Notre histoire
Le MAF est né de la rencontre et de l’alliance d’artistes, prospectivistes et mécènes passionné·es qui, ensemble dans les années 20, ont renouvelé notre façon d’envisager l’avenir. Iels ont élaboré et développé l’archéologie des futurs, une discipline novatrice qui examine les cultures matérielles des sociétés futures avec la rigueur méthodologique et la distance critique de l’archéologie traditionnelle. Cette approche unique nous permet à partir des objets et traces de comprendre les valeurs, les rêves et les défis des mondes et civilisations à venir.
Au cœur de notre démarche réside une conviction fondamentale : l’avenir appartient à tous·tes. Le MAF s’engage ainsi à démocratiser l’accès à la fabrique des futurs ; à stimuler le dialogue intergénérationnel et interculturel, à cultiver l’imagination critique et la créativité collective ; préserver et partager les artefacts des futurs alternatifs.
Notre collection permanente présente des artefacts soigneusement sélectionnés qui témoignent de la diversité des futurs possibles. Chaque objet, chaque document raconte une histoire unique sur les modes de vie, les technologies, et les relations sociales qui pourraient émerger demain.
Plus qu’un Musée
Le MAF est plus qu’un musée – c’est un espace vivant où les communautés locales sont invitées à donner forme à leurs visions d’avenir ; les artistes et designers à explorer de nouvelles formes d’expression et « d’aller vers » ; les chercheureuses et praticien·nes à expérimenter des méthodes et outils de co-construction. C’est par dessus tout un espace où les visiteureuses deviennent des acteurices actif·ves dans la construction de leurs souhaitables.
Notre vision est claire : un futur pour toustes ne peut être imaginé par quelques-uns. C’est pourquoi nous nous efforçons chaque jour de rendre l’exploration des futurs possibles accessible, inclusive et participative.
Notre impact
Le MAF se distingue par sa capacité à connecter des personnes de tous horizons aux cultures futures pour créer des espaces d’expérimentation et d’apprentissage collaboratif. Ses collections rendent tangibles les trajectoires possibles et catalysent des conversations essentielles sur notre devenir collectif
Pour amplifier notre impact, nous avons créé le MoMAF, extension mobile du Musée qui parcourt les territoires et investit tout interstice — écoles, tiers-lieux et lieux associatifs, établissements publics — pour y donner à expérimenter des futurs alternatifs. Cette initiative incarne notre engagement à dépasser les frontières géographiques et sociales qui limitent l’accès notre imagination collective.
Le MAF est une initiative d’éducation populaire, nos ateliers, expositions et événements sont accessibles gratuitement à toustes et reposent sur l’engagement bénévole des membres de Futurons ! Vous pouvez soutenir notre activité au moyen de dons, de mises à disposition de lieux ou de matériaux et moyens de production.